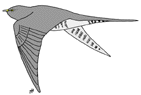carte de répartition (cliquez sur la carte) |
 carte de répartition (cliquez sur la carte) |
Le plus montagnard de nos vautours est un sédentaire dont l'aire se situe dans une falaise entre 600 et 2200 mètres d'altitude. Comme pour les autres grands rapaces non migrateurs, la parade nuptiale a lieu en plein hiver et la ponte de 2 ufs est déposée en janvier. L'incubation dure 55 à 58 jours et l'envol des jeunes n'a lieu qu'après un séjour de 4 mois au nid. Un record ! Il peut même rester encore plusieurs mois sur le territoire de ses parents avant que ces derniers ne l'invitent à aller voir ailleurs.
Le gypaète barbu est présent
en Corse avec une population stable de 8 couples nicheurs, dans
les Pyrénées avec 19 couples en 1996 et les Alpes
où la réintroduction est en cours et où des
oiseaux ont été relâchés depuis 1986
en Haute-Savoie et dans le Mercantour (1 couple a construit un
nid en 1995 et déposé une ponte en 1996). Mais la
population française ne se porte pas à merveille
puisque seulement 2 jeunes ont été élevés
par les 28 couples présents !
Étant donné l'étendue importante du territoire
de chaque couple, le gypaète barbu est visible partout
dans la montagne corse et dans la partie occidentale des Pyrénées.
Il peut également être observé çà
et là dans la chaîne alpine et ces observations doivent
être transmises aux organismes chargés de surveiller
son retour.
Il est indispensable de pratiquer la randonnée pédestre et se promener sur les alpages au-delà de la limite de la forêt d'altitude pour espérer observer le gypaète barbu. Néanmoins, pour les moins sportifs d'entre vous, certains cols pyrénéens et corses sont accessibles en voiture et sont d'excellents sites d'observation, le tout étant d'être présent au moment où il passe En fait, durant toute la journée, il survole sans relâche l'immensité de son territoire à la recherche de carcasses d'animaux sauvages et domestiques déjà nettoyées par les autres vautours et dont il pourra avaler la moelle de certains os ou fragments d'os après les avoir brisés en les laissant tomber sur un rocher.
La silhouette du gypaète barbu en vol avec ses ailes pointues et sa longue queue cunéiforme est typique et ressemble plus à celle d'un faucon géant qu'à un vautour. Son envergure pouvant atteindre 2,70 mètres, il fait partie de nos plus grands rapaces. L'adulte se reconnaît à sa tête, sa poitrine et son ventre orangés alors que le juvénile est sombre avec la tête foncée. Les immatures possèdent des plumages intermédiaires.
Les gypaètes barbus émettent parfois des sifflements lorsque plusieurs individus sont regroupés autour d'un cadavre.
Longtemps accusé d'enlever les agneaux et même les jeunes enfants ce dont il est évidemment totalement incapable , le gypaète barbu a été exterminé de maintes régions et notamment des Alpes à l'aide du fusil et du poison. Aujourd'hui qu'il est intégralement protégé, les populations pyrénéennes et corses sont encore extrèmement fragiles et nécessitent des mesures de protection concrêtes. Un nourrissage des gypaètes en hiver a d'ailleurs été entamé en Corse où, faute de nourriture suffisante, sur les 8 couples de l'île, un seul jeune a pu prendre son envol en 1995 ! Dans toute la chaîne des Alpes l'espoir revient avec la réintroduction débutée en 1986 et qui permet de revoir ce majestueux voilier aussi bien dans les Alpes suisses que françaises.