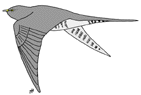|
 carte de répartition (cliquez sur la carte) |
 |
 carte de répartition (cliquez sur la carte) |
Insectivore, le faucon kobez passe
la mauvaise saison en Afrique. Nicheur dans les steppes d'Europe
de l'Est et d'Asie occidentale, il migre en Afrique orientale
à l'automne mais remonte plus à l'ouest lors de
la migration printanière, favorisant son observation dans
l'Est de la France et en Suisse.
Le retour intervient donc vers la fin avril, s'intensifie en mai
et se prolonge jusqu'en juin, mois où l'on peut noter des
oiseaux immatures non accouplés. Sur ses sites de nidification,
la ponte a lieu fin mai-début juin et les 4 ufs sont couvés
pendant 28 jours en moyenne. L'envol des jeunes a lieu après
un séjour de 4 semaines au nid. Deux des nichées
observées en France en 1993 donnent un envol des jeunes
entre le 10 et le 15 août.
La migration vers l'Afrique est moins notée en Europe occidentale
car les oiseaux suivent un trajet retour nettement plus oriental
qu'à l'aller. Néanmoins, des kobez sont notés,
en plus petits nombres donc, de la fin août à la
mi-octobre.
Le faucon kobez est avant tout
un migrateur dans nos pays de l'Europe de l'Ouest. Néanmoins,
il a niché en France en 1993, dans les départements
de Vendée, de l'Isère et des Bouches-du-Rhône.
La migration printanière nous apporte donc beaucoup plus
d'oiseaux, en majorité des adultes, qui se rendent vers
leurs sites de reproduction d'Europe de l'Est. À l'automne
par contre, seuls quelques individus, le plus souvent des juvéniles,
sont observés çà et là dans nos pays.
Certains sites sont particulièrement favorables au faucon
kobez, espèce typique des steppes et des vastes plaines
bordées d'arbres où il installe son nid dans un
vieux nid de corvidé. La plaine de la Crau dans les Bouches-du-Rhône
lui convient à merveille de même que le sud de l'étang
de Biguglia en Corse où, dans la première quinzaine
de mai, des groupes de plusieurs dizaines d'oiseaux peuvent être
notés. Ces oiseaux remontent ensuite vers le nord en longeant
la vallée du Rhône puis, soit passent par la Suisse,
soit contournent les montagnes du Jura par le Nord en suivant
le Doubs. Dans ces différentes régions, certains
sites accueillent chaque année des kobez pour une halte
de quelques jours parfois.
Le faucon kobez est, comme le crécerelle, un adepte du vol sur place qui lui permet de repérer les insectes au sol. Donc, durant le mois de mai, prenez l'habitude de donner un coup de jumelles sur tout petit faucon effectuant le vol de Saint-Esprit. Peut-être aurez-vous une agréable surprise ? Sinon il aime avant tout se percher sur les fils et les poteaux électriques et téléphoniques d'où il guette ses proies, et sa très faible méfiance envers l'homme permet souvent d'excellentes observations. Observer une petite troupe chassant face au vent est un spectacle inoubliable, rappelant le ballet aérien des guifettes noires au-dessus d'un étang.
Avec son plumage bleu nuit uniforme, ses culottes et ses pattes rouges, le mâle de faucon kobez est inconfondable. En vol, l'extrémité de ses ailes sont plus claires que le reste du plumage. Sachez simplement reconnaître les mâles immatures au dessous de leurs ailes striés de blanc et de gris foncé. La femelle, dont la tête, la poitrine et le ventre orangés contrastent avec ses parties supérieures striées de gris clair et foncé, ne peut pas être confondue avec une femelle de crécerelle. À l'automne, le juvénile est plus terne et son plumage davantage dans tons bruns, requiert une observation plus méticuleuse pour ne pas le confondre avec un jeune faucon hobereau.
Durant les périodes de migration, les faucons kobez ne sont guère bavards, même lorsqu'ils chassent les insectes en petite troupe. Les seules manifestations vocales ont en fait lieu sur les territoires de reproduction.
Le faucon kobez n'a rien à craindre de l'homme dans nos pays d'Europe de l'Ouest, d'une part grâce à sa protection intégrale, et d'autre part à cause de sa rareté. Par contre le développement de l'agriculture intensive en Europe de l'Est, inondant le sol de pesticides tuant ou empoisonnant ses proies favorites et transformant les vastes étendues herbeuses en monocultures, contribuent fortement à sa raréfaction. Le faucon kobez est d'ailleurs en fort déclin au niveau européen.