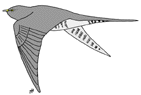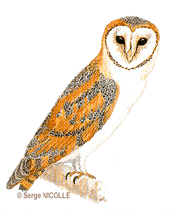 |
 carte de répartition (cliquez sur la carte) |
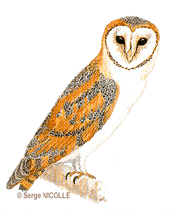 |
 carte de répartition (cliquez sur la carte) |
Les effraies ayant survécu aux rigueurs de l'hiver réoccupent leurs sites de nidification dès le mois de mars. Les chuintements des deux protagonistes du couple se font de plus en plus pressants jusqu'à la ponte qui a lieu dans un recoin obscure du clocher du village ou d'une grange tranquille. 6 oeufs en moyenne (maximum connu de 12 !) sont pondus début avril pour la première nichée et dans la seconde quinzaine de juillet lors de seconde ponte. L'incubation dure 31 à 33 jours et les jeunes prennent leur envol au bout de 8 à 10 semaines. Commence alors l'erratisme juvénile qui mènera les jeunes oiseaux à plusieurs dizaines, exceptionnellement plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu de naissance.Ces déplacements sont nettement plus importants que chez d'autres strigidés sédentaires comme la hulotte ou la chevêche. La mortalité est très élevée chez les oiseaux de l'année ainsi que chez les adultes qui restent fidèles à leur territoire quelque soit le temps. Les effraies périssent régulièrement de faim lors d'hiver à enneigement supérieur à une semaine.
Oiseau de plaine, des milieux
ouverts et du bocage, l'effraie des clochers a depuis longtemps
déserté les falaises où elle nichait autrefois
pour s'installer dans les constructions humaines comme les églises,
les granges et les greniers. On la retrouve néanmoins dans
certains secteurs rocheux où elle niche dans une petite
caverne loin de tout village. Il lui arrive même d'installer
son nid dans une cavité d'un arbre creux, notamment dans
l'Ouest de la France. Elle évite les milieux fermés
comme les massifs forestiers et hésite à s'élever
à plus de 1000 mètres d'altitude.
L'effraie est présente sur tout le territoire français,
Corse comprise, à l'exception notable des zones de haute
montagne des Alpes, des Pyrénées et du Massif Central.
La Belgique, la Suisse et le Luxembourg sont également
uniformément habités.
Quoique strictement nocturne,
l'effraie des clochers est probablement le rapace nocturne que
vous aurez le plus de chances d'observer la nuit dans les phares
de votre voiture. Fréquemment posée à l'affût
sur les piquets en bord de route, elle survole également
les espaces dégagés pour y repérer un campagnol
ou une musaraigne.
Mais ce sont principalement par les amoncellements de pelotes
de rejection en dessous de ses reposoirs favoris que vous vous
rendrez compte qu'elle visite régulièrement votre
grenier, le clocher de votre église ou la grange de votre
voisin. Amusez-vous à décortiquer ces pelotes et
identifiez à l'aide d'un ouvrage de référence
les crânes qu'elles contiennent. Vous connaîtrez ainsi
non seulement son régime alimentaire, mais aussi quelles
sont les espèces de micromammifères présents
autour de chez vous.
En plein jour, il faut impérativement limiter vos visites
dans les lieux où elle niche car l'effraie des clochers,
comme tous les rapaces nocturnes, profite de la journée
pour se reposer. Tout dérangement peut avoir des conséquences
néfastes, surtout si elle abandonne sa couvée pendant
toute une journée. Mieux vous attendre la nuit tombée
et se poster de façon à voir l'orifice d'où
elle sortira après avoir annoncé sa présence
par de longs chuintements.
Comme la plupart des rapaces nocturnes, l'effraie se nourrit essentiellement de micromammifères. Les campagnols, les souris et les mulots occupent une place importante dans son régime auquel elle incorpore également les musaraignes que dédaignent la plupart des autres prédateurs, à poil ou à plume. Les oiseaux sont également consommés mais en plus petit nombre, de même que les chauves-souris et les gros insectes comme les hannetons.
L'effraie des clochers, surnommée
la dame blanche dans bien des régions, est certainement
notre rapace nocturne le plus facilement identifiable. Deux formes
sont présentes dans nos régions. La forme blanche
montre une répartition occidentale en Europe et est présente
dans nos quatre pays. Sa face, sa poitrine, son ventre et le dessous
de ses ailes blancs permettent de la reconnaître au premier
coup d'il lorsqu'elle vole. Cette silhouette blanche sortant du
clocher d'une église ou voletant au-dessus d'un cimetière
lui a valu bien des problèmes de la part d'esprits crédules
qui voyaient en elle ni plus ni moins qu'un fantôme. La
forme rousse, présente plutôt en Europe Centrale
et de l'Est, et dans nos contrées les plus orientales,
remplace le blanc par du roux. Seul le disque facial en forme
de cur reste blanc.
Posée, son dos et ses ailes aux couleurs mordorées
et grises sont des critères suffisants pour son identification.
Pour qui ne connaît pas
la chouette effraie, entendre ses chuintements en pleine nuit
noire à proximité d'une église ou d'un cimetière
a de quoi glacer le sang du plus téméraire d'entre
nous. Ces cris, dont il existe quelques variations et dont le
chant est composé, ne ressemblent absolument pas aux ululements
des autres rapaces nocturnes. Postez-vous devant votre clocher
préféré et attendez la tombée de la
nuit pour avoir droit à cet étrange concert, surtout
lorsqu'un adulte amène une proie à ses jeunes affamés.
Comme pour tous les rapaces nocturnes, le vol de l'effraie est
totalement silencieux et lui permet d'attraper des micromammifères
sans que ceux-ci ne l'entendent venir.
Son nouveau qualificatif risque
bientôt de ne plus lui convenir car, à cause de l'engrillagement
systématique des clochers pour empêcher l'accès
aux pigeons, les effraies ne trouvent plus guère de clochers
à leur disposition. Pourtant, jusqu'aux années 1980,
il n'existait guère de commune qui n'hébergeait
un couple de ce nocturne dans son église. Aujourd'hui,
afin de favoriser leur réimplantation dans ces endroits
calmes, la Ligue pour la Protection des Oiseaux et d'autres associations
de protection de la nature proposent l'installation de nichoirs
dans les clochers avec un tunnel d'accès donnant directement
sur l'extérieur, que seules les chouettes fréquentent.
Hormis ce manque de logement et malgré leur statut d'espèce
intégralement protégée par la loi, les effraies
subissent encore d'autres destructions. Si le temps où
elles étaient clouées sur les portes de grange pour
conjurer le mauvais sort semble enfin révolu, elles paient
aujourd'hui un lourd tribut aux collisions avec les véhicules.
Seules une vitesse réduite de la part des automobilistes
et la plantation de haies dans les zones les plus meurtrières,
obligeant les effraies à prendre de l'altitude lorsqu'elles
traversent une route, peuvent freiner ce massacre.
Enfin l'empoisonnement des rongeurs, aussi bien dans les prairies
lors de pullulation ou dans les jardins à l'aide de produits
anticoagulants, entraîne également de fortes mortalités
chez les effraies qui consomment à leur tour ces rongeurs
empoisonnés, affaiblis et moribonds.
Reste que, de nos jours, la cause de mortalité la plus
importante, est heureusement naturelle et a lieu lors d'hivers
rigoureux lorsqu'une couche de neige persiste au sol pendant plus
d'une semaine et dissimule ses proies à l'effraie.
Accueillir un couple d'effraies dans sa propriété nécessite l'existence d'un endroit calme, grange ou grenier, où ce nocturne pourra tranquillement installer son "nid". Ce site ne doit pas recevoir votre visite régulière et doit être hors de portée des fouines et des chats domestiques. Le mieux est d'y installer un nichoir que vous placerez sur une poutre maîtresse du bâtiment. Vous prendrez également soin de lui laisser un accès permanent vers l'extérieur.