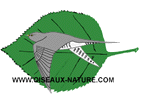Buse variable - Common Buzzard
Buteo buteo - famille des Accipitridés

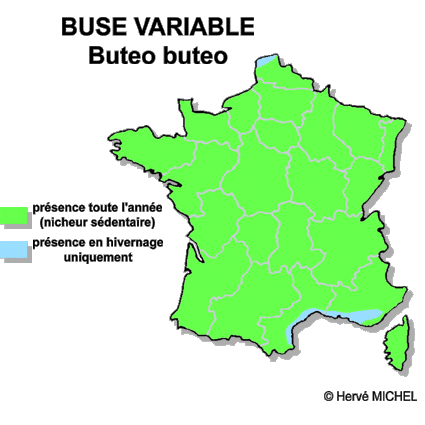
Buse variable - Common Buzzard
Buteo buteo - famille des Accipitridés

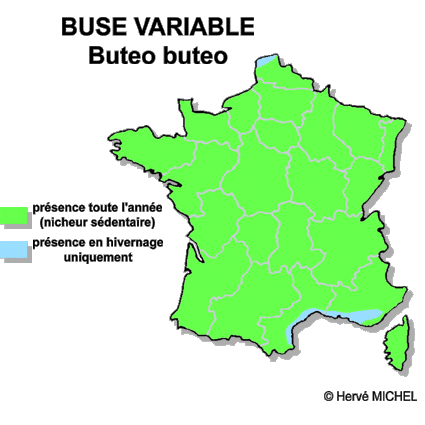
 |
||
|
Lunéville (54) - 26.12.2001 Nikon CP990 + Apotelevid Leica x20 (photo Hervé MICHEL) |
 Lunéville (54) - 26.12.2001 Nikon CP990 + Apotelevid Leica x20 (photo Hervé MICHEL) |
L'année de la buse variable
Après une saison hivernale
passée à observer les buses variables figées
sur leurs piquets de parc, c'est toujours un bonheur, par une
journée ensoleillée de février, de les voir
cercler haut dans le ciel en miaulant, réanimant la campagne
engourdie des frimas de l'hiver.
Les parades nuptiales commencent toujours assez tôt pour
ce rapace en majorité sédentaire. Dès février,
parfois dès fin décembre dans nos régions
les plus méridionales, les couples se forment et rechargent
de branchages leur nid de l'année précédente
ou en construisent un nouveau. Les pontes de 1 à 4 ufs
sont déposées entre le 15 mars et le début
de mai pour les plus tardives. L'incubation dure 31 à 35
jours et les jeunes volants quittent le nid à l'âge
de 6 à 7 semaines.
Nos populations sont relativement sédentaires. Seuls les
jeunes quittent leur lieu de naissance, poussés par l'erratisme
juvénile qui peut les mener à plusieurs centaines
de kilomètres de leur lieu de naissance. Les vagues de
froid important et surtout un enneigement persistant peuvent,
comme en janvier 1997, entraîner une forte mortalité et une migration
vers le sud des populations du Nord-Est de la
France.
Dès l'automne, nos buses variables sont rejointes par de
nombreux migrateurs originaires des régions septentrionales
et orientales de l'Europe de l'Ouest qui viennent passer la mauvaise
saison sous un climat plus tempéré et remontent
vers leurs contrées d'origine en février-mars.
La buse variable est le rapace
le plus commun et le plus répandu dans nos pays, seuls
le pourtour méditerranéen et les abords de la Mer
du Nord semblent évités en période de reproduction.
Même la Corse est uniformément colonisée.
En hiver, cette espèce est omniprésente en France,
Belgique, Suisse et Luxembourg à l'exception des zones
montagnardes trop enneigées à cette époque
de l'année.
C'est en pleine campagne, de préférence dans les
zones bocagères qu'il faut la rechercher. L'alternance
de petits bois, de haies, de prairies, de prés pâturés
et de cultures lui convient à merveille. La buse variable
fréquente également les massifs forestiers où
elle chasse dans les grandes allées, les clairières
et les lisières.
Dans bien des régions de France, lorsque vous observez un rapace diurne, a fortiori si ce dernier est posé sur un piquet de parc, vous pouvez, avant même d'avoir ajusté vos jumelles, être sûr à 99 % qu'il s'agit d'une buse variable. La buse variable que vous aurez détecté à distance, restera impassible si vous passez en voiture devant elle sans ralentir ; par contre, si vous avez le malheur de freiner ou de couper le moteur, l'envol sera immédiat. Elle s'observe souvent à terre dans les prés à la recherche de lombrics, déambulant maladroitement sur ses pattes peu adaptées à la marche. En effet, si les rongeurs, campagnols et mulots, qu'elle chasse patiemment à l'affût depuis un perchoir, constituent la base de son régime alimentaire, les vers de terre ne sont pas négligés car leur apport énergétique est considérable, notamment lors de l'élevage des jeunes.
Posée sur un piquet de
parc, sa silhouette massive de rapace de taille moyenne, son plumage
à dominance brune sur les parties supérieures et
le plastron clair bien visible sur sa poitrine permettent facilement
de reconnaître la buse variable. Une bonne connaissance
de cette dernière est indispensable car elle sert de référence
pour l'identification des autres rapaces diurnes.
L'adjectif variable accolé à son nom de genre ne
signifie pas que son plumage, à l'instar de celui du lagopède
alpin, varie selon les saisons, mais que les plumages sont extrêmement
variables d'un individu à l'autre sans relation avec la
zone géographique d'où l'oiseau est originaire.
Certaines buses apparaissent très foncées, d'autres
très claires telles les fameuses buses blanches, d'autres
posséderont un croupion blanc, d'autres des marques laissant
planer le doute de leur identité tant elles ressemblent
à une buse pattue, un circaète Jean-le-Blanc ou
une bondrée apivore.
Pourtant, pour l'observateur expérimenté, ces confusions,
classiques chez le débutant, sont pratiquement impossibles
tant les différences de plumage, de structure, de vol et
de comportement, voire même d'habitats sont importantes.
N'oubliez jamais que, pour identifier une espèce rare ou
nouvelle pour vous, ce n'est pas un détail du plumage qui
vous permettra de l'identifier, mais bien un faisceau de critères
que seules l'expérience et une parfaite connaissance des
espèces communes vous apporteront.
En vol, la buse variable possède des ailes relativement
larges, arrondies à leurs extrémités et légèrement
relevées vues de face. La queue est également arrondie,
notamment lorsqu'elle plane. Le vol sur place est assez couramment
observé, surtout face à un vent fort, et ne doit
pas vous faire conclure trop vite qu'il s'agit d'une buse pattue.
Les miaulements émis lors des vols circulaires des parades nuptiales sont les principales émissions vocales de la buse variable et font partie du patrimoine sonore de nos campagnes. Elles sont également émises tout au long de l'année lorsque les oiseaux planent haut dans le ciel, parfois en famille après l'envol des jeunes ou lors des migrations.
Longtemps persécutée
par l'homme qui ne voyait en elle qu'une destructrice du gibier
et des oiseaux de basse-cour, la buse variable a vu ses effectifs
au plus bas durant les années 1950-1960. Sa protection
intégrale en 1972, l'interdiction des pièges à
mâchoire puis des poisons comme la strychnine lui ont permis
de retrouver assez rapidement des populations importantes qui
en font aujourd'hui notre rapace le plus commun en bien des régions.
Aujourd'hui l'empoisonnement systématique des rongeurs
lors de pullulation comme en Franche-Comté durant l'hiver
1996/1997 peut avoir des conséquences dramatiques pour
la buse variable qui consomment ces campagnols affaiblis voire
mourants et s'empoisonne à son tour. L'électrocution
sur le réseau basse et moyenne tension d'EDF est aussi
une cause non négligeable de mortalité qui nécessiterait
l'enfouissement des lignes les plus meurtrières.
Quant aux chasseurs qui estiment à tort que la buse variable
est la cause de destruction du petit gibier (perdrix, lièvres,)
et qui aimeraient pouvoir à nouveau la détruire
en lui ôtant son statut d'espèces protégée,
ils feraient mieux de se battre aux côtés des protecteurs
de la nature contre la réelle cause de disparition des
perdrix : l'agriculture intensive et les remembrements.